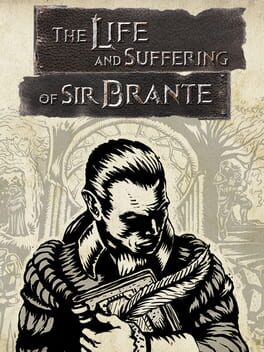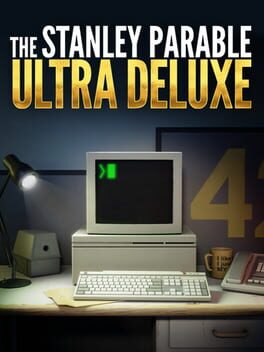MaxDeslongchamps
En fin de vie, Sir Brante est attablé pour écrire ses mémoires. Il se bute à une question philosophique : qu’est-ce qui détermine la vie d’un être humain ? À moi de répondre à même le livre : l’individu lui-même, le monde qui l’entoure, une force supérieure ou le hasard. La page suivante décrit la naissance de Brante et celles d’après font état de son parcours de vie, de l’enfance à la vie adulte, les chapitres étant divisés selon les moments fatidiques dans lesquels je peux intervenir à sa place. Le ton est donné : c’est l’individu, moi, le joueur, qui exerce des choix et va façonner la vie de Brante. Je prends des décisions, développe les traits de personnalité du personnage, déverrouille des conditions à des choix futurs, ouvre le champ des possibles jusqu’à tout se retourne contre moi. Brante évolue dans un monde brutal, violent, impitoyable. Je dois naviguer à travers les valeurs divergentes de chaque membre de sa famille, la scission qui s’opère au sein de la société, les machinations politiques et plus encore. J’ai voulu jouer un Brante toute en nuance, à la fois en recherche de vérités théologiques et loyal envers les êtres les plus authentiques et bienveillants. Mais ma partie s’est terminée en bain de sang. Une fin horrible, éradiquant tout ce que j’avais essayé de mettre en place dans le monde. Qu’est-ce qui détermine la vie d’un être humain, donc ? J’ai changé d’idée.
Voilà un jeu qui aurait pu se contenter de prendre l’art comme enrobage thématique, mais ce n’est pas le cas. Il explore véritablement le concept d’art, en nous mettant parfois à la place de l’artiste peintre et d’autres fois en métaphorisant les mécaniques de jeu pour véhiculer une expérience esthétique. C’est tout à son honneur ! Please, Touch the Artwork contient trois « expositions », trois volets dans lesquels est présenté un style abstrait de peinture où l’on doit reconstituer une toile incomplète en suivant des règles qui contraignent l’application de couleurs et le tracé de lignes. L’abstraction des peintures va de pair avec celle des mécaniques de jeu, notamment durant l’exposition « New York », où l’on est amené à naviguer à la manière de Pac-Man sur des traits de pinceau formant un espace labyrinthique. Cette exposition est d’ailleurs la plus réussie des trois. L’objectif est de récupérer dans le labyrinthe les lettres de vers d’un poème à propos de l’expérience d’arriver dans une grande ville et d’entretenir ainsi une relation à distance. La juxtaposition des lignes évoque un gigantesque réseau urbain qui se transforme jusqu’à nous engloutir ou presque. Chaque « toile » crée un espace dans lequel se perdre, servant d’appui aux vers et renforçant l’expressivité du poème.
Malheureusement, les expositions sont inégales en ce sens que le lien entre l’art et le jeu n’est pas toujours noué étroitement, en particulier lorsqu’une toile prend la forme d’un puzzle à résoudre et que l’on doit trouver la réponse au problème posé par le designer. En offrant de la résistance, en ponctuant notre « visite au musée » de difficultés, il semble que le jeu incarne une contradiction qu’il promet pourtant d’abolir. Après tout, le plaisir de voir de l’art, c’est celui de laisser libre cours à l’imagination et à la contemplation, c’est s’arrêter devant une toile et repartir quand bon nous semble. D’avoir la bonne réponse ou la bonne interprétation importe peu. Un jeu qui emprunte à l’art devrait alors se détacher des notions de succès et d’échec, libérer son public de tout impératif de performance. Si l’innovation artistique du jeu vidéo est de nous permettre de toucher l’œuvre, nous devrions pouvoir le faire avec un désintéressement total, sans conformité à un objectif prédéfini.
Malheureusement, les expositions sont inégales en ce sens que le lien entre l’art et le jeu n’est pas toujours noué étroitement, en particulier lorsqu’une toile prend la forme d’un puzzle à résoudre et que l’on doit trouver la réponse au problème posé par le designer. En offrant de la résistance, en ponctuant notre « visite au musée » de difficultés, il semble que le jeu incarne une contradiction qu’il promet pourtant d’abolir. Après tout, le plaisir de voir de l’art, c’est celui de laisser libre cours à l’imagination et à la contemplation, c’est s’arrêter devant une toile et repartir quand bon nous semble. D’avoir la bonne réponse ou la bonne interprétation importe peu. Un jeu qui emprunte à l’art devrait alors se détacher des notions de succès et d’échec, libérer son public de tout impératif de performance. Si l’innovation artistique du jeu vidéo est de nous permettre de toucher l’œuvre, nous devrions pouvoir le faire avec un désintéressement total, sans conformité à un objectif prédéfini.
2023
Si mon souvenir est bon, Sébastien Genvo affirmait dans l’une de ses vidéos YouTube que le plaisir de jouer à Mario Bros. (Nintendo, 1985) comportait plusieurs affinités avec celui vécu devant les premiers films de course-poursuite, au début du 20e siècle. De voir un corps doté d’une mobilité décuplée se heurter à toute sorte de surfaces sans jamais se blesser véritablement, même après avoir reçu un pot de fleurs tombé du 3e étage sur la tête ou être atterri sur les épines d’un spiny, transgresse les lois de la physique et bouleverse l’imaginaire. Le personnage exprime brièvement sa douleur avant de recommencer à gesticuler dans tous les sens, comme si rien ne s’était passé. Pizza Tower (Tour de Pizza, 2023), c’est un film de course-poursuite ou jeu de Mario sur les stéroïdes pour chevaux (si telle chose existe). Il incarne l’esprit du burlesque et des cartoons dans son idée la plus fondamentale.
Peppino Spaghetti, restaurateur d'une pizzéria et probablement le cousin éloigné de Mario, est capable de contorsions des plus spectaculaires, s’étirant comme un élastique, s’écrasant comme une éponge et rebondissant comme une balle de caoutchouc à travers les couloirs serpentins du jeu. Peppino reçoit des coups, des décharges électriques et des brûlures sans jamais se désintégrer — sa « mort » est par ailleurs un fait rare, les conditions d’échec étant appliquées seulement dans des circonstances particulières, notamment durant l’affrontement d’un boss. Ses courses atteignent la vitesse de pointe de Sonic le hérisson et finissent par une collision inévitable dans un mur apparaissant tout d’un coup, où Peppino est écrabouillé tel un moustique dans le pare-brise d’une voiture traversant le parc Lavérendrye. La comparaison aux cartoons est d’autant plus juste si l’on considère les écrans de chargement, de score et de multiplicateur de points, qui mettent en vedette Peppino dans une splendeur digne de certains gros plans que dessinait John Kricfalusi, créateur de Ren & Stimpy (1991-95). Bien qu’on ne tombe pas dans la représentation répugnante du détail corporel, où chaque poil, veine et sécrétion saute au visage, on donne au personnage une charmante laideur qui correspond tout à fait au caractère grotesque qu’est celui de plaquer des pointes de pizza anthropomorphisées et des poulets rôtis coiffés de sombrero à la manière d’un joueur de football américain. Le rythme frénétique de l’action laisse transparaître sur le visage de Peppino une panoplie d’émotions, de l’anxiété au rire maniaque, qui résonnent bien avec ce que nous vivons durant l’expérience de jeu et dévoilent le rapport compliqué que nous entretenons avec notre propre corps.
Peppino Spaghetti, restaurateur d'une pizzéria et probablement le cousin éloigné de Mario, est capable de contorsions des plus spectaculaires, s’étirant comme un élastique, s’écrasant comme une éponge et rebondissant comme une balle de caoutchouc à travers les couloirs serpentins du jeu. Peppino reçoit des coups, des décharges électriques et des brûlures sans jamais se désintégrer — sa « mort » est par ailleurs un fait rare, les conditions d’échec étant appliquées seulement dans des circonstances particulières, notamment durant l’affrontement d’un boss. Ses courses atteignent la vitesse de pointe de Sonic le hérisson et finissent par une collision inévitable dans un mur apparaissant tout d’un coup, où Peppino est écrabouillé tel un moustique dans le pare-brise d’une voiture traversant le parc Lavérendrye. La comparaison aux cartoons est d’autant plus juste si l’on considère les écrans de chargement, de score et de multiplicateur de points, qui mettent en vedette Peppino dans une splendeur digne de certains gros plans que dessinait John Kricfalusi, créateur de Ren & Stimpy (1991-95). Bien qu’on ne tombe pas dans la représentation répugnante du détail corporel, où chaque poil, veine et sécrétion saute au visage, on donne au personnage une charmante laideur qui correspond tout à fait au caractère grotesque qu’est celui de plaquer des pointes de pizza anthropomorphisées et des poulets rôtis coiffés de sombrero à la manière d’un joueur de football américain. Le rythme frénétique de l’action laisse transparaître sur le visage de Peppino une panoplie d’émotions, de l’anxiété au rire maniaque, qui résonnent bien avec ce que nous vivons durant l’expérience de jeu et dévoilent le rapport compliqué que nous entretenons avec notre propre corps.
En règle générale, chaque opus d’une série de jeux vidéo propose un nouveau lieu à explorer. The Elder Scrolls en est un bon exemple : chacun des jeux de la série est sous-titré par l’une des régions du continent de Tamriel. Jouer à Skyrim, c’est jouer dans le paysage nordique qui le caractérise et n’existe pas dans Morrowind ou Oblivion — à ma connaissance, du moins. Il est de même pour les suites, comme Psychonauts, qui se déroule d’abord au camp de vacances où le jeune Raz pratique ses habilités psychiques, puis dans les quartiers généraux de l’agence éponyme, le personnage jouable ayant monté dans les échelons depuis ses prouesses de l’opus initial. Une suite en jeu vidéo implique habituellement de reprendre des mécaniques fondamentales à la série afin de les recontextualiser spatialement. Mêmes pouvoirs, mêmes habiletés, mais un nouveau monde à explorer, un nouvel effort à cartographier l’environnement, à tâter ses extrémités, à intérioriser ses chemins et ses secrets.
C’est justement ce rapport à l’espace qui fait de Tears of the Kingdom une suite intéressante. Au lieu de nous projeter dans un univers déroutant, le jeu partage essentiellement la carte de son prédécesseur, Breath of the Wild. On y retrouve les mêmes régions, villages, points de repère, là où ils étaient dans l’opus d’avant. Tears of the Kingdom n’apparaît pas comme une suite ordinaire, faite dans les conventions, et ce malgré l'aspect inédit de sa structure verticale, incluant des îles flottantes et un vaste réseau souterrain. À peu près tout ce qui se cache entre ces deux couches verticales a été retenu. De parcourir les plaines d’Hyrule procure donc une expérience particulière. Il ne s’agit pas d’une inquiétante étrangeté, mais d'un sentiment de déjà vu. Le souvenir inexact de Breath of the Wild surgit à tout moment. On pense reconnaître quelques éléments du décor modifiés ici et là. On perçoit les monstres et les personnages familiers se tenir à des endroits décalés. À vrai dire, Tears of the Kingdom ressemble plutôt à une version remixée de son prédécesseur. Il donne la vague impression de connaître son monde et finit par nous étonner avec d’habiles ajouts et substitutions. C’est à se demander si nous avons véritablement affaire à une suite.
C’est justement ce rapport à l’espace qui fait de Tears of the Kingdom une suite intéressante. Au lieu de nous projeter dans un univers déroutant, le jeu partage essentiellement la carte de son prédécesseur, Breath of the Wild. On y retrouve les mêmes régions, villages, points de repère, là où ils étaient dans l’opus d’avant. Tears of the Kingdom n’apparaît pas comme une suite ordinaire, faite dans les conventions, et ce malgré l'aspect inédit de sa structure verticale, incluant des îles flottantes et un vaste réseau souterrain. À peu près tout ce qui se cache entre ces deux couches verticales a été retenu. De parcourir les plaines d’Hyrule procure donc une expérience particulière. Il ne s’agit pas d’une inquiétante étrangeté, mais d'un sentiment de déjà vu. Le souvenir inexact de Breath of the Wild surgit à tout moment. On pense reconnaître quelques éléments du décor modifiés ici et là. On perçoit les monstres et les personnages familiers se tenir à des endroits décalés. À vrai dire, Tears of the Kingdom ressemble plutôt à une version remixée de son prédécesseur. Il donne la vague impression de connaître son monde et finit par nous étonner avec d’habiles ajouts et substitutions. C’est à se demander si nous avons véritablement affaire à une suite.
2018
Inutile de donner une voix ou de grands yeux à un objet inerte pour l’anthropomorphiser. FAR: Lone Sails l’a compris. Unique au monde, un enfant part en expédition dans une contrée dévastée. Son seul allié s’avère un monstre mécanique, un navire sur roues muni de soupapes, d’engrenages et de leviers, qui déplace sa lourde charpente péniblement. Il demande à être nourri constamment d’essence pour se mouvoir de gauche à droite, comme un train à la vapeur avide de charbon. Ses mécanismes sont dispersés dans ses entrailles, des organes aux fonctions propres. Le véhicule n’est pas sous notre contrôle direct, une simple extension de notre volonté, telle l’automobile contemporaine. Nous devons sans cesse agiter le petit personnage pour traverser la coque du vaisseau afin d’éteindre les feux, distribuer le carburant et reprendre les commandes. Lorsque le navire acquiert sa vitesse de pointe, qu’il devient une bête fonçant à toute allure dans l’obscurité de la nuit, nous ne pouvons que remettre notre confiance en lui, en sa capacité de nous porter dans ces territoires hostiles, quitte à sortir de son ventre pour examiner les dégâts suivant une collision, puis les réparer avant de poursuivre le voyage.
Inutile de laisser apercevoir l’expression d’un visage pour susciter une émotion. FAR: Lone Sails le prouve bien : l’attachement est une activité. Elle se déploie à la manière du jardinier penché sur ses plantes, lorsque nous prenons soin des choses qui nous entourent. La machine a besoin d’attentions pour fonctionner. Nous pouvons compter sur elle à condition de bien l’entretenir. Dans cette relation d’interdépendance, nous développons de l’affection pour ce qui se résume en fait à une structure de fer. Nous nous inquiétons alors quand la créature s’échappe du cadre de la caméra, dévalant une pente pendant que nous traînons à l’extérieur à la recherche de carburant, et nous réjouissons de la retrouver indemne, prête à se remettre en marche. Car il faut d’abord donner de nous-mêmes, insuffler un peu de vie au monde, pour que s’ouvre par la suite la gamme des émotions.
Inutile de laisser apercevoir l’expression d’un visage pour susciter une émotion. FAR: Lone Sails le prouve bien : l’attachement est une activité. Elle se déploie à la manière du jardinier penché sur ses plantes, lorsque nous prenons soin des choses qui nous entourent. La machine a besoin d’attentions pour fonctionner. Nous pouvons compter sur elle à condition de bien l’entretenir. Dans cette relation d’interdépendance, nous développons de l’affection pour ce qui se résume en fait à une structure de fer. Nous nous inquiétons alors quand la créature s’échappe du cadre de la caméra, dévalant une pente pendant que nous traînons à l’extérieur à la recherche de carburant, et nous réjouissons de la retrouver indemne, prête à se remettre en marche. Car il faut d’abord donner de nous-mêmes, insuffler un peu de vie au monde, pour que s’ouvre par la suite la gamme des émotions.
Les étoiles dans le ciel ont disparu. Remplaçons-les par le bordel dans lequel les êtres humains vivent. Car, et c’est une vérité prononcée par le roi du Cosmos, « la Terre est vraiment pleine de choses », de trop de choses, pourrait-on ajouter. La mission de notre avatar le prince est d’utiliser une balle adhésive pour incorporer le désordre des Terriens, commençant avec des objets de petite taille (boutons, punaises, chewing-gums, dés…), pour ensuite gagner en dimension et absorber tout le reste, un peu comme s'il roulait sa boule de neige pour former le corps d’un bonhomme de neige ou, si l’on prend une analogie encore plus appropriée, traînait et façonnait sa propre merde à la manière du bousier. Après tout, chaque niveau de Katamari Damacy est parsemé de tas d’ordures, d’objets qui se retrouvent là où ils ne devraient pas se retrouver. Les maisons, les rues et les parcs sont absolument bordéliques, les surfaces étant recouvertes de gogosses, de bidules, de ce qui déborde de nos frigos, s’empile dans nos remises et s’amasse dans les dépotoirs. Des objets identiques sont généralement regroupés ensemble dans un même rayon comme pour nous rappeler les rendements de la production en chaîne qui dépassent nos réels besoins. Le plaisir de nettoyer les pièces d’une maison aboutit à l’euphorie d’assimiler la maison elle-même, ses habitants et tout le reste du décor. Dans un sens, le but du jeu n’est pas vraiment de ramasser le fouillis dans lequel les humains vivent, mais de débarrasser la Terre de l’humanité. Voilà un message radicalement écologique !
Quand les walking simulators ont gagné en traction au début des années 2010, les joueurs se sont rapidement demandés s’ils étaient véritablement des jeux, et les détracteurs n’ont pas hésité à répondre par la négative pour justifier leur mépris. The Stanley Parable s’est néanmoins glissé hors de cette controverse, connaissant un succès unanime auquel ses prédécesseurs, Dear Esther et Gone Home n’ont pas eu le droit. Pourquoi ? C’est ce que nous nous étions demandés lors d’un épisode de la baladodiffusion Profil Ludique. Nous avions alors comparé The Stanley Parable à un agent double : avec ses blagues réservées aux amateurs de jeux vidéo, son combat symbolique entre Stanley et le narrateur, entre le jeu libre et le récit ordonné, il a réussi à convaincre les gamers qu’il était de leur côté, dissimulant sa véritable nature de walking sim. C’était là l’une des nombreuses ironies restées inaperçues dans la réception du jeu.
Presque dix ans plus tard, comme s’il voulait que son commentaire frappe la cible de plein fouet, The Stanley Parable: Ultra Deluxe penche vers un style d’humour grinçant, s’assurant de proposer des scénarios encore plus arbitraires et de prolonger ses blagues jusqu’au malaise. Son ton acerbe vise toutes les sphères du jeu vidéo : les franchises malhonnêtes et leurs conceptions bidons du progrès, l’obsession des gamers pour la nostalgie, l’autorité dont ils se prévalent en tant que fans sur la direction d’un sequel, leur insignifiant besoin de satisfaction et j’en passe. Bien que toujours aussi volubile, le narrateur ne fait pas que montrer les dents; il mord, car c’est par la blessure que l’ironie fait son chemin. Ce faisant, la réédition du jeu semble prendre ses distances par rapport à la culture vidéoludique, s’en désaffilier plutôt que d’en faire partie en jouant gaiement avec les codes. Le masque est donc tombé. L’agent double a révélé son identité.
Presque dix ans plus tard, comme s’il voulait que son commentaire frappe la cible de plein fouet, The Stanley Parable: Ultra Deluxe penche vers un style d’humour grinçant, s’assurant de proposer des scénarios encore plus arbitraires et de prolonger ses blagues jusqu’au malaise. Son ton acerbe vise toutes les sphères du jeu vidéo : les franchises malhonnêtes et leurs conceptions bidons du progrès, l’obsession des gamers pour la nostalgie, l’autorité dont ils se prévalent en tant que fans sur la direction d’un sequel, leur insignifiant besoin de satisfaction et j’en passe. Bien que toujours aussi volubile, le narrateur ne fait pas que montrer les dents; il mord, car c’est par la blessure que l’ironie fait son chemin. Ce faisant, la réédition du jeu semble prendre ses distances par rapport à la culture vidéoludique, s’en désaffilier plutôt que d’en faire partie en jouant gaiement avec les codes. Le masque est donc tombé. L’agent double a révélé son identité.
2022
On est témoin avec Citizen Sleeper (et son prédécesseur Disco Elysium) d’un changement de paradigme du côté du jeu vidéo indépendant aux ambitions hypernarratives, où l’influence du jeu de rôle prend une place beaucoup plus importante que celle, par exemple, du cinéma. Au lieu de s’enfermer à l’intérieur d’une pure structure d’arborescence, risquant d’offrir une série de choix ni bons ni mauvais, comme c’est le cas avec les « fictions interactives », le jeu propose un système tout à fait organique, qui représente à merveille la société de l’Erlin’s Eye, la station spatiale où se déroule le jeu, et la situation du nouveau venu qu’est notre Sleeper, une sorte de réplicant à la Blade Runner dont l’humanité pose question. La progression en jeu n’a rien d’un parcours dont les chemins ont été tracés d’avance, car la vie sur l’Erlin’s Eye subit des mutations en fonction de ses activités internes, comme les allées et venues de personnages non jouables, mais aussi parce que notre champ d’action s’avère limité par le jet de dés, les ressources épuisables et une économie somme toute assez sévère. En conséquence, les possibilités d’une action en jeu réussie varient selon les circonstances, les opportunités, la chance, nous demandant parfois de la résignation en cas d’échec. Et là se trouve un aspect important du jeu : notre Sleeper n’est qu’un élément d’un système, une « entité » comme le remarquent certains personnages non jouables. Parce qu’il est autonome, ce système limite toujours le contrôle que nous exerçons sur le quotidien du Sleeper et de l’Erlin’s Eye. C’est ainsi que Citizen Sleeper nous donne l’impression d’évoluer au sein d’une société véritable, rejetant la rhétorique naïve de jeux vidéo selon lesquels nous sommes les maîtres de notre destin. Coincé entre les joutes de pouvoir, les intérêts individuels et ses propres conditions matérielles, le Sleeper n’a pas comme objectif de trôner au sommet, de l’emporter sur ses adversaires, mais seulement de trouver sa place dans un monde qu’il n’a pas choisi.
Tiré d'un texte que j'ai écrit pour la revue Captures : « Une tendance de l’industrie vidéoludique est de nous faire jouer les explorateurs de terres étrangères. On tient fréquemment le rôle d’un nomade, d’un aventurier en quête de découvertes, libre d’emprunter les chemins ou corridors de mondes fictifs. Dans les jeux vidéo en général, la sédentarité est une exception. La maison est par conséquent un lieu dont les formes n’ont pas encore été pleinement explorées, se limitant trop souvent au manoir gothique dans les jeux d’horreur, au refuge dans les jeux de survie, au campement dans les jeux de rôle et à la maison de rêve dans les jeux de simulation. En contraste avec ces conventions, le jeu The Stillness of the Wind (Cardenas, 2019) introduit un personnage qui n’est jamais ailleurs que chez lui, enfermé dans le coffre à souvenirs que sont sa maison, sa cour et sa fermette. Ce jeu représente la maison comme un lieu par excellence de réconfort et de repli, séparé d’un monde extérieur imprévisible et chaotique. Il souligne que la maison nous attache à son territoire et, qu’à notre tour, on s’attache à elle; qu’on l’habite et qu’elle nous habite. [...] »
2017
Superbe réflexion sur la mort — ou est-ce sur la vie ? Qu’est-ce qui nous pousse, lorsque l’on regarde en bas du précipice, à rester accrochés en haut ? Far from Noise pose la question à travers la conversation entre un cerf empreint de la sagesse de Henry David Thoreau et un chauffeur dont la voiture est en équilibre précaire sur les rebords d’une falaise. La conversation a lieu à l’intérieur d’un unique plan fixe (ou presque) plaqué devant un horizon en perpétuelle transformation. Elle est ponctuée de musiques envoûtantes, d’interludes contemplatifs, de spectacles de la nature, nous berçant dans une profonde méditation sur l’importance de demeurer sur la terre ferme, de tenir bon.